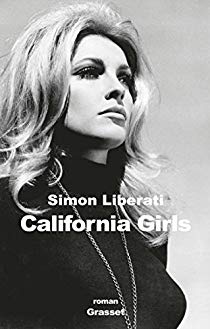Ces dernières semaines, deux événements n’ayant – a priori – aucun rapport l’un avec l’autre se sont télescopés.
Tout d’abord, les révélations de Médiapart sur les dîners fastueux organisés aux frais du contribuable par François de Rugy, qui a depuis démissionné de son poste de Ministre de la transition écologique.
Puis la venue de Greta Thunberg, la jeune militante écologiste suédoise, à l’Assemblée nationale le 23 juillet dernier.
Chacun de ces deux événements a « libéré » une parole réactionnaire. La première niait avec véhémence les abus et la corruption ayant cours dans la vie politique. La seconde s’insurgeait du fait qu’une adolescente de seize ans puisse s’emparer du discours politique, au motif que celle-ci serait « trop jeune », « incompétente », « manipulée » – les pleurnicheries, insultes et tweets rageurs s’accompagnant parfois d’appels au boycott.
On pourrait se contenter de fustiger le vieuxconnisme flamboyant de nos politiques, mais je trouvais intéressant d’analyser ces discours, car ils mettent en exergue la rhétorique habituellement utilisée par les dominants lorsqu’ils vacillent de leur piédestal.
Comme on le verra, les méthodes employées sont toujours les mêmes. Pour contrer la justice et le progrès social, les conservateurs emploient des armes qu’ils espèrent tranchantes, mais qui s’avèrent désespérément rouillées.
Dévoyer le sens des mots : l’exemple de la « délation »
La délation, ce mot sombre qui évoque les pires heures de l’Histoire, est définie comme une « dénonciation intéressée, méprisable, inspirée par la vengeance, la jalousie ou la cupidité » (Larousse). Elle consiste à fournir des informations concernant un individu, en général à l’insu de ce dernier, pour un motif généralement contraire à la morale ou à l’éthique.
Mot fort et lourd de symboles, il a fait son grand retour médiatique à l’occasion du mouvement « Me too », lorsque les agresseurs, acculés, ont tenté de se raccrocher aux branches en se faisant passer pour les victimes d’un terrible complot.
Ainsi, les femmes qui dénoncent les violences dont elles ont été victimes feraient quelque chose de honteux et de méprisable, et leur volonté de trouver justice serait éthiquement condamnable.
Mais cette technique qui consiste à inverser les rôles (et donc la culpabilité), tout aussi grotesque qu’elle soit, n’a rien de très surprenant.
Lorsque les dominants se font épingler pour des actes juridiquement répréhensibles (violences, corruption, abus de pouvoir, etc), l’un des seuls mécanismes de défense qu’ils peuvent actionner est celui qui consiste à se dire victime d’une cabale.
C’est, par exemple, Denis Baupin qui attaque en diffamation les femmes qu’il a agressées sexuellement (fort heureusement, le karma existe : il a été débouté ♥).
Et donc, le terme de « délation » (un acte motivé par la vengeance) est devenu dans la bouche des dominant.es pris.es la main dans le sac un synonyme de « dénonciation » (un acte visant à faire justice). Un glissement sémantique dont personne ne semble s’émouvoir.
Dans l’affaire de Rugy, alors que Mediapart n’a fait que révéler des faits moralement et juridiquement condamnables (exerçant ainsi sa mission, qui est d’informer), les accusations de délation n’ont pas tardé à faire leur come-back (on les attendait : elles reviennent toujours). « Il y a encore dans notre pays le droit de la défense, la possibilité de réponse, sinon ça devient la République de la délation », a ainsi répliqué Emmanuel Macron, lorsqu’il fut sommé de s’expliquer.
Donc, quiconque révélerait des faits moralement et/ou juridiquement condamnables ferait de la « délation ». Drôle de conception de l’éthique et de la justice – d’autant que cela ne supprime aucunement à la personne dénoncée son droit à se défendre.
François de Rugy a quant à lui évoqué un « journalisme de démolition », se comparant à une « cible [qu’on] crible de flèches ».
Mais quelle est la différence entre le « journalisme de démolition », si tant est qu’une telle chose existe, et le journalisme d’investigation ? A moins que le droit d’informer, pilier essentiel de toute démocratie, ne devienne soudainement incriminable lorsqu’il révèle les abus de pouvoir des puissant.es ?
Rhétorique de la mauvaise foi : quand les puissant.es tentent de défendre leurs privilèges
Dans l’exercice de mauvaise foi auquel semblent se livrer nombre de dominant.es, le recours aux sophismes est particulièrement prisé.
L’un des plus connus est « l’épouvantail » (dit aussi « homme de paille »), technique qui consiste à travestir les arguments de son adversaire ou à les présenter de manière erronée, de sorte qu’il devient facile de les ridiculiser.
Mais l’exagération est une autre technique fréquemment utilisée. Voyons ainsi cet extrait d’un article concernant la venue de Greta Thunberg à l’Assemblée nationale, publié sur le site Agoravox :
« La défense de notre environnement ne mérite-t-elle pas mieux qu’un gourou instrumentalisé, jouant sur les peurs et les émotions collectives à des fins de culpabilisation individuelle ? » […] Ou comment une militante écologiste de 16 ans se transforme en leader d’une secte dangereuse, qui cherche à manipuler l’opinion pour mieux répandre son idéologie dévastatrice.
Je ne résiste d’ailleurs pas à vous partager cet autre extrait, tout à fait savoureux :
« Le monde attendait un leader écologique charismatique, légitime et compétent. On vient de lui servir un grand chaman de l’écolo-catastrophisme »
Cet argument est d’une mauvaise foi confondante, car les messages écologistes, même prononcés par de grands « leaders » bardés de diplômes, provoquent la même irritation chez les réacs. Et pour cause : l’urgence écologique se heurte violemment au dogme capitaliste, sur lequel repose nos sociétés modernes. Inutile de faire semblant d’attendre un grand messie qui nous sensibilisera intelligemment à la question (le rapport du GIEC, publié en octobre 2018 et sur lequel s’appuie d’ailleurs Greta Thunberg, remplit parfaitement cet office) : le discours écologiste a toujours provoqué des réactions de rejet, quelle que soit la source dont il émane.

Mais intéressons-nous maintenant à ce stratagème rhétorique qui consiste à tenter de délégitimer son adversaire à grands recours d’attaques ad personam. Dans le cas de Greta Thunberg, rien de plus facile : son jeune âge, son manque d’expérience et son syndrome d’Asperger sont des cibles toutes trouvées.
Ainsi, ce qui met en rage les tenanciers du pouvoir traditionnel – le fait que Greta Thunberg ne soit pas un homme de cinquante ans, doté d’un diplôme de l’ENA et d’une carrière politique bien rôdée – va être utilisé comme un argument pour l’attaquer. Puisqu’elle ne correspond pas à la norme, son discours est nécessairement illégitime.
L’avantage, c’est que les attaques sur la personne permettent d’éviter soigneusement le fond du débat. Et les mâles encravatés n’ont peur de rien – après tout, selon l’adage, plus c’est gros, plus ça passe. « Le message de Greta Thunberg est catastrophiste ; il aggrave le réchauffement climatique », professe ainsi l’un de ses détracteurs, qui va jusqu’à prédire « une vraie révolution, qui serait vraisemblablement d’extrême droite » en cas de victoire idéologique des idées de Greta Thunberg. Il l’accuse ensuite d’être « instrumentalisée par les ayatollahs écolo-catastrophistes qui veulent imposer aux jeunes une réduction massive de leurs libertés » (celles que nous confèrent le réchauffement climatique, sans doute ?).
« Non à la terreur par la peur », se lamente un autre de ses contempteurs, sans qu’on sache trop ce que signifie cette phrase (un indice : rien).
Il est intéressant de noter que les arguments avancés par les détracteurs de Greta Thunberg pourraient aisément être retournés contre eux-mêmes : eux non plus ne sont pas de « grand scientifiques », eux aussi sont instrumentalisés (par les lobbies industriels), eux aussi sont obsédés par une seule chose (conserver le pouvoir). Qu’ont fait les élu.es ces 20 dernières années pour enrayer le changement climatique ? Qui s’est seulement intéressé à ce sujet ?
Il est également fascinant de voir à quel point la prise de parole d’une jeune fille politisée puisse déclencher autant de violence, d’animosité, de rejet. Le pluralisme des opinions n’est-il pas l’un des fondements de la démocratie ? Par ailleurs, doit-on attendre d’être adulte pour avoir des opinions fortes, et l’envie de les exprimer ? (toute personne qui a déjà eu 16 ans un jour vous répondra non)
Greta Thunberg dérange parce qu’elle renvoie aux parasites de la vie politique leur propre inaction et incompétence. Elle dérange parce qu’elle prouve qu’il n’est nul besoin d’être un homme de cinquante ans pour avoir un discours politique influent. Elle dérange, enfin, parce qu’elle change complètement le paradigme habituel du pouvoir. Greta Thunberg a seize ans, elle n’a pas fait Sciences Po, elle n’a pas de réelle expérience professionnelle ou politique. Mais cela ne l’empêche guère d’être une actrice importante de la lutte écologique. Et de faire entendre sa voix.
Dans leurs prises de position outrées et leurs appels au boycott, les monsieurs tout rouges et tout colères qu’une adolescente leur vole la vedette n’ont rien fait de plus qu’exhiber leur masculinité fragile, eux qui tremblent d’effroi lorsque de nouvelles règles du jeu semblent se mettre en place – et avec elles, la possibilité d’un nouveau partage du pouvoir.
Certes, tous les détracteurs de Greta Thunberg ne sont pas des hommes. Mais ce sont eux que l’on a particulièrement entendus ces derniers jours.
Ce sont eux, également, qui en 2016 s’étaient insurgés contre la venue de Pamela Anderson à l’Assemblée nationale pour parler du gavage des oies et des canards (la star américaine est une militante de la cause animale). « Dinde gavée au silicone », « degré zéro de la politique », « elle n’y connaît rien », a t-on alors pu entendre. Le message sous-jacent est toujours le même : la parole politique appartient aux hommes, et n’est légitime que lorsqu’elle correspond à un modèle ultra-codifié.
Toutes ineptes qu’elles soient, ces lamentations permettent aux dominants (qui se sentent) menacés de continuer à occuper le terrain médiatique, et donc d’exister. De dire « je suis toujours là ». Et par là-même, de réaffirmer leur pouvoir.
Au commencement, la peur
En réalité, quel que soit le sujet auquel elle s’attaque, la rhétorique réactionnaire ne cache qu’une seule et même chose : la peur.
La peur de perdre son statut de dominant, et donc ses privilèges.
La peur de se faire remplacer, la peur de devoir céder sa place à des personnes que l’on n’envisageait pas autrefois comme des adversaires : les femmes, les jeunes, les écolos, les progressistes.
La peur de l’égalité.
La peur, consubstantielle, du changement.
Cette peur n’est pas nécessairement conscientisée, et les réactions de rejet qu’elle engendre ne sont pas toujours rationnelles.
Mais une chose demeure : les dominant.es construisent leur identité sur l’idée même du pouvoir, et la façon dont s’exerce celui-ci. Or, s’ils ne peuvent plus – ou moins – dominer, c’est toute leur identité qui s’effondre.
En 1991, la féministe américaine Susan Faludi publiait « Backlash », un essai dans lequel elle décrit le « retour de bâton » consécutif à chaque petite avancée pour les droits des femmes.
Cette offensive réactionnaire est valable pour le mouvement féministe, mais elle peut également être étendue à toute forme de progrès social. Lorsque les fondations de l’ancien monde commencent à trembler, les personnes qui en récoltaient les fruits tremblent avec elles.
Toutes ces levées de boucliers, qu’elles soient masquées derrière des arguments grotesques ou une rhétorique plus mesurée (1), ne sont finalement qu’un symptôme : celui d’une peur des dominant.es de voir le pouvoir leur échapper.
Mais les signes de résistance ne sont pas forcément un mauvais présage. Lorsque la parole des puissant.es cherche désespérément à se faire (ré)entendre, c’est le signe que la société a entamé sa mue. Lentement, mais sûrement.