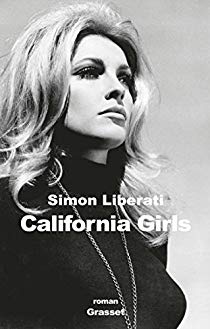À l’heure où j’écris ces lignes, en France, depuis le début de l’année, 75 femmes ont péri sous les coups de leur conjoint ou ex-conjoint.
Terrible décompte, qui marque le paroxysme d’une domination masculine à l’œuvre jusque dans les relations amoureuses.
La partie immergée de l’iceberg, ce sont ces centaines de milliers de femmes qui subissent, chaque année, des violences conjugales (en 2017, 219 000 femmes majeures ont déclaré avoir été victimes de violences physiques et/ou sexuelles par leur conjoint ou ex-conjoint sur une année).
En Île de France, 88% des victimes de violences commises par le partenaire enregistrées par les services de police sont des femmes ; 96% des personnes condamnées pour des faits de violences (de toute nature) entre partenaires sont des hommes.
Une femme sur huit est victime de violences psychologiques dans son couple (INSEE).
Les femmes sont ainsi plus exposées que les hommes au risque d’être l’objet de violences psychologiques. Elles sont aussi plus souvent victimes de violences physiques ou sexuelles, ces violences s’accompagnant plus fréquemment d’atteintes psychologiques ou d’agressions verbales.
Au-delà de ces froides statistiques, nous avons toutes et tous dans notre entourage des femmes malmenées (physiquement ou psychologiquement) par leur partenaire, et qui pourtant restent obstinément enfermées dans cette boucle de l’enfer. Nous connaissons toutes et tous cette femme qui ne tombe que sur des « connards » et enchaîne les relations toxiques ; cette femme qui souffre de dépendance affective, et préférera toujours être mal accompagnée plutôt que seule. Nous avons toutes et tous eu au moins une amie dont le partenaire contrôlait la tenue, les sorties, les loisirs, les horaires ; dont la laide jalousie passait pour une « preuve d’amour » ; dont les remarques froides et humiliantes ont laissé des traces profondes. Nous avons toutes et tous en tête ce stéréotype de la « femme blessée », qui n’a pas d’autre choix, croit-on, que d’accepter son sort avec fatalité.
Et parfois, cette femme, c’est nous.
*
Je ne suis pas une parfaite féministe – de toute façon, une telle chose n’existe pas. Ainsi, je l’avoue, je me pose souvent cette question : mais pourquoi tant de femmes sont-elles victimes de violences conjugales (violences psychologiques incluses) ? Pourquoi tant de femmes se retrouvent-elles sous l’emprise d’un conjoint qui les contrôle ou les maltraite ? Pourquoi, comble du pire, font-elles même parfois des enfants avec ?
Je ne me demande pas pourquoi les femmes restent – ça, je le sais. Je connais le phénomène d’emprise, la difficulté de partir quand on est dépendante financièrement et/ou quand on a des enfants, le danger qu’accompagne la fuite (la rupture étant l’un des principaux facteurs déclenchants du féminicide). Non : je me demande pourquoi elles acceptent, dès le départ, d’entrer dans ce type de relation.
Si le féminisme part du postulat que les femmes ne sont pas par nature plus faibles, plus timorées ni plus « soumises » que les hommes, alors il doit s’interroger sur la manière dont cette faiblesse se construit, sur la manière dont elle créé une porosité à la violence masculine, et surtout : sur la façon dont les femmes peuvent y échapper.
Car les chiffres des violences conjugales ne procèdent pas d’un malheureux hasard, ni d’une triste fatalité.
A la source, se trouvent la masculinité toxique mais aussi la féminité traditionnelle, cette construction sociale qui prépare et asservit les femmes à un destin prétendument inéluctable. Ce que nous avons fait du genre masculin est un problème, mais il n’est pas le seul. La construction du féminin, entre insatisfaction de soi, vulnérabilité et recherche permanente de protection, en est un autre.
Et ce que nous avons créé, nous pouvons maintenant le défaire.
La violence, une expression de la domination masculine
Les violences conjugales (1) sont un continuum. Elles ne commencent ni ne finissent pas toutes par des coups, des cris, du sang. Il faut avant tout les voir comme une échelle, une sorte de verre gradué qui commence avec la violence psychologique et/ou verbale.
Mais qu’est-ce que la violence psychologique ? Nous en avons souvent une image distordue, « fantasmée », alors même qu’elle possède de nombreux visages. Certaines manifestations peuvent à ce titre paraître anodines, parce qu’elles sont banalisées, voire romantisées par la société : par exemple, la jalousie, le contrôle de l’autre, le paternalisme ou la possessivité. Pourtant, elles s’inscrivent pleinement dans le cadre de la domination masculine – dont elles sont d’ailleurs l’un des symptômes. Ainsi, certains hommes commettent des violences parce qu’ils considèrent que les femmes (leurs femmes) sont des choses, qui peuvent à ce titre être contrôlées, muselées et mises sous tutelle.
Dévaloriser l’autre, le critiquer, l’humilier, lui imposer des contraintes (ne sors pas après telle heure, ne porte pas tel vêtement, n’achète pas tel objet, arrête de voir cette amie, ne parle pas aux hommes…), le tirer vers le bas, lui parler mal voire l’insulter, lui faire du chantage, outrepasser son consentement, contrôler ses allées et venues, ses conversations, son téléphone, son compte en banque, son historique Internet… constituent des violences psychologiques. Bien évidemment, un reproche ou un mot plus haut que l’autre ne constituent pas en tant que tels des violences. C’est la récurrence de la situation, notamment, qui permet de les qualifier.
Lisez cet article éclairant sur les cyberviolences, que l’on connaît finalement mal.
Ce qu’il faut bien comprendre, c’est que la violence psychologique procède du même mécanisme que la violence physique : toutes deux composent les facettes d’une même pièce. Même si la première ne débouche pas nécessairement sur la seconde, elles sont interdépendantes.

*
Constat terrible, mais réel : les femmes sont conditionnées à tolérer la violence masculine. Par exemple, les romances auxquelles nous sommes biberonnées depuis le plus jeune âge nous donnent souvent à fantasmer sur des comportements problématiques, comme le contrôle et la possessivité – deux éléments qui n’ont rien à faire dans une relation saine. De Twilight à 50 nuances de Grey en passant par After, les romances pour adolescentes et jeunes adultes sont la plupart du temps coulées sur le même modèle hétéro-patriarcal, avec un héros « viril » qui domine de manière décomplexée sa partenaire, et une jeune femme naïve et inexpérimentée qui se soumet entièrement à lui – tout en étant censée aimer ça.
Ou comment notre environnement façonne des fantasmes et des désirs qui, sur le long terme, peuvent s’avérer dangereux.
(1) Les violences conjugales sont protéiformes : elles ne sont pas seulement physiques mais peuvent aussi être verbales, sexuelles, psychologiques, économiques… (voir tableau)
Victime, nom féminin
On rappelle souvent les chiffres des féminicides ou les statistiques des violences conjugales sans vraiment se préoccuper du cadre dans lesquelles elles s’exercent. Pourtant, les violences faites aux femmes sont indissociables du système patriarcal : elles n’existent que parce que la domination masculine a encore cours.
Depuis quelques années, nous remettons de plus en plus en cause la masculinité toxique et ses fruits pourris. C’est une excellente chose – et une première étape. Mais nous ne devons pas seulement éduquer les hommes. Nous devons aussi donner du pouvoir aux femmes.
J’entre maintenant sur un terrain miné. Le sujet est délicat, voire tabou. Et pourtant : impossible de dissocier le pouvoir exercé par les hommes sur les femmes de la soumission de celles-ci. Les hommes ne peuvent dominer que parce que les femmes acceptent, de manière tacite, d’être dominées. Et c’est particulièrement vrai dans le cadre du couple, lieu « sanctuarisé » s’il en est.
Le but n’est évidemment pas de dire que de nombreuses femmes sont violentées parce qu’elles l’ont bien cherché ou parce qu’elles l’ont voulu. Il n’y a qu’un seul coupable, et ce sera TOUJOURS l’agresseur. Néanmoins, beaucoup trop de femmes « acceptent » encore d’être dominées au nom de l’amour. Comme s’il s’agissait d’une fatalité inhérente à leur condition de femme, une sorte d’héritage immatériel venu du fond des siècles. Subir. Se persuader que c’est « normal ». C’est comme ça. On finit par s’y habituer.
Les femmes n’entrent pas dans des relations abusives de manière consciente, parce qu’elles aiment être brimées, qu’elles sont naturellement soumises ou un peu maso sur les bords. Elles ne se disent pas : « chouette ! encore un sombre connard » lorsqu’elles se mettent en couple avec un homme toxique. Tout cela s’opère de manière inconsciente, parce que la société les a éduquées à avoir un seuil de tolérance particulièrement haut et un niveau d’exigence corollairement bas. À voir dans des comportements abusifs de l’amour. À être dépendante des autres – particulièrement des hommes. À se détester en silence. À ne pas pouvoir se suffire à elles-mêmes (la dépendance émotionnelle des femmes est une manne formidable pour le patriarcat). Et, par-dessous-tout, à considérer le célibat comme la pire des humiliations – tout, plutôt que d’être seule.
Et cela donne pléthore d’articles dans les magazines féminins (du style : « Pourquoi vous ne tombez que sur des connards » ou, version plus poétique, « Comment être enfin heureuse en amour »), faisant ainsi passer un problème politique pour une simple problématique individuelle.
Redonner du pouvoir
Nous ne saurions évoquer le système patriarcal (et ses conséquences) sans pointer du doigt l’une des branches sur lesquels il est assis : la dévalorisation du féminin.
À ce titre, la confiance en soi est un sujet politique pour les femmes.
Jusqu’à il y a peu, je levais les yeux au ciel lorsque j’entendais dire qu’il est « difficile d’avoir confiance en soi quand on est une femme ». Victimisation inutile, me disais-je. Je ne voyais pas le rapport. Et puis j’ai fini par comprendre. Quand l’élément féminin est dévalorisé par la société, quand les femmes sont sommées dès le plus jeune âge d’être belles, douces, minces, parfaites, quand leur physique est régulièrement scruté, quand elles reçoivent des remarques sexistes, quand leurs décisions sont remises en cause, leurs trajectoires strictement codifiées (quoi ? à 35 ans, tu n’es toujours pas mariée ?) ou leurs accomplissements dévalués (tu as obtenu une promotion ? c’est bien ma chérie, mais quand est-ce que tu fais un enfant ?), la confiance en soi peut être difficile à acquérir.
Dévalorisées par la société, les femmes finissent alors, par un effet miroir, à se dévaloriser elles-mêmes. À penser qu’elles ne sont pas assez, qu’elles ont peu de mérite, qu’elles ne doivent pas trop en demander. C’est dans cette vulnérabilité construite de toutes pièces que se trouve la faille.
Ne pas s’aimer est un risque. Il y a, j’en suis convaincue, une forte corrélation entre l’estime que l’on se porte et la qualité de nos relations amoureuses.
Le début de ma vie amoureuse fut à ce titre largement insatisfaisant : aucun abus (on en viendrait presque à se trouver chanceuse pour ça), mais une constellation de mini-relations ayant l’intérêt et la saveur d’un cornet de frites molles. Mes besoins, mes envies n’étaient pas respectées – par les autres, certes, mais avant tout par moi-même. J’étais cette fille qui tapait « comment faire tomber amoureux un homme » dans Google et prenait de bon cœur les miettes qu’un type médiocre consentait à lui offrir.
Est-ce un hasard si, à l’époque, encore conditionnée par les injonctions à la féminité traditionnelle, je manquais de confiance en moi ?
Je suis convaincue que non.
Amour, genre et violences
Par peur de culpabiliser les victimes, nous détournons le regard.
Nous le dirigeons uniquement vers les hommes – et c’est une nécessité puisqu’ils représentent l’immense majorité des auteurs de violence, mais ce n’est pas suffisant. La lutte restera vaine si nous ne donnons pas du pouvoir aux femmes ; si nous ne leur fournissons pas les outils pour s’émanciper. Si nous ne nous saisissons pas des attendus de la féminité traditionnelle, si nous ne concédons pas qu’ils puissent représenter un danger.
La masculinité et la féminité en tant que constructions sociales agissent comme des vases communicants. Nous apprenons aux hommes à être des agresseurs, et aux femmes à se faire proies. C’est dans cette « dualité » socialement construite que les genres se nourrissent l’un de l’autre. Et c’est pour cette raison que nous devons sortir de la rhétorique fataliste, qui sous-entend que nous sommes dépourvu.es de toute marge de manœuvre, pour nous intéresser à la façon dont nous devons enfin armer les femmes. De savoir ; de confiance ; de connaissances ; de pouvoir.
Car nous n’expliquons pas aux femmes ce qu’est une histoire d’amour « normale », c’est à dire saine et équilibrée.
Nous ne leur apprenons pas à repérer les signaux d’alarme dans une relation amoureuse. Nous les gavons dès la naissance d’une vision sexiste et distordue de l’amour hétérosexuel, censé justifier les pires comportements.
La complaisance de la société envers les hommes dominateurs et violents joue également un rôle : de manière collective, nous finissons par considérer des situations abusives comme des « histoires de couple » ou de banals conflits conjugaux. Ignorant les mécanismes systémiques – et réversibles – qu’il y a derrière.
Maintenir les femmes dans l’exaltation d’une féminité obéissante, désarmée, dépendante, dans cette vulnérabilité construite de toutes pièces, et dans l’ignorance de ce qu’est l’amour et le respect, permet la pérennisation de ces violences.
*
Que faire maintenant ?
Nous devons éduquer les femmes à prendre confiance et à trouver le pouvoir en elles, à repérer les « red flags » (drapeaux rouges, en anglais) qui annoncent une relation toxique, et à exiger le respect et le bonheur qu’elles méritent. Une relation amoureuse bascule très rarement dans la violence d’un seul coup, comme on actionnerait un interrupteur. Les signes « avant-coureurs » sont connus : apprenons aux femmes à les repérer. Et à les refuser.
Les normes sociales qui enferment les femmes dans des trajectoires rigides doivent également être remises en cause : cessons de faire du couple hétérosexuel l’aboutissement suprême, arrêtons d’abreuver les filles de contes de fées puis de romances toxiques, cessons de voir les femmes comme de futures épouses en puissance pour les considérer enfin comme des êtres à part entière, cessons de glorifier les relations amoureuses et le mariage, cessons d’en faire les indispensables jalons de toute vie de femme réussie. N’oublions pas que le couple ne met pas les femmes à l’abri : en fait, c’est même le contraire. Statistiquement, les femmes sont plus en danger dans leur propre foyer que partout ailleurs.
À ce titre, l’entourage a un rôle important à jouer : trop de proches des victimes les culpabilisent encore, les enjoignent à se montrer « plus conciliantes » et « moins exigeantes » lorsqu’elles rapportent des abus, balaient le problème en proposant des solutions stériles (« allez voir un psy », « essaye de rallumer la flamme avec de la lingerie sexy », « prenez du temps à deux »…), voire se montrent complaisants à l’égard des hommes violents.
Souvenons-nous enfin qu’il n’y a pas de déterminisme : la violence et la volonté de dominer ne sont pas intrinsèques aux hommes, tout comme la soumission n’est pas inhérente aux femmes. Nous ne faisons que reproduire des modèles genrés, fruits d’un conditionnement vieux de plusieurs milliers d’années.
Enfermer les femmes dans un rôle de victime « par essence » (impuissante, inerte, dépourvue de libre arbitre), comme le font de nombreux mouvements féministes, ne résoudra jamais rien – nous jouons cette partition depuis des années, et les chiffres des violences, tout comme ceux des féminicides, ne baissent pas. Les femmes ne tombent pas dans le piège des violences conjugales comme on tomberait dans un trou, sans préambule, sans conditionnement préalable, au gré d’un hasard inéluctable.
Éduquons donc les hommes à ne pas dominer, et les femmes à n’accepter aucun abus.
C’est certainement dans cette recherche d’un équilibre nouveau, que se niche l’un des combats contre les violences conjugales.